Cinquième chronique de ma série “Anticipations”, dans laquelle je reviens cette fois sur des bibliothèques de fin du monde, autour de livres et de films comme autant d’effets miroirs pour parler de nature et de culture, de préservation de l’art et de littérature, même quand tout s’effondre autour…
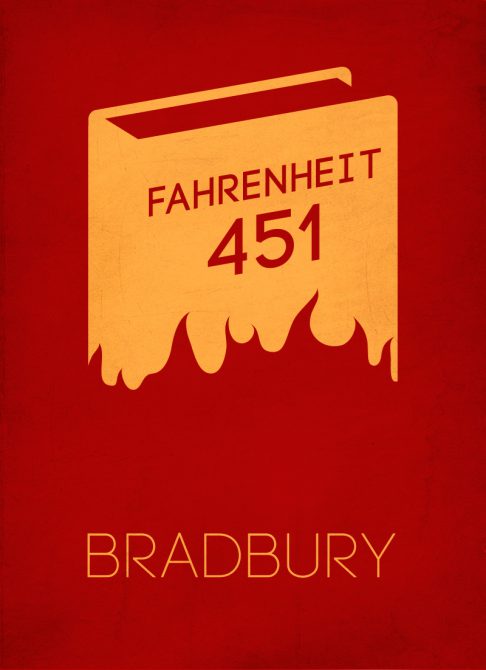
232.8 degrés Celsius
Préserver la culture, les arts, la littérature, quand bien même il n’y aurait plus personne pour les savourer ? Emmagasiner des œuvres d’art dans des musées déserts… Cela a-t-il un sens ? Quand la température chute irrémédiablement, faut-il brûler les livres pour gagner quelques degrés de chaleur et sauver des vies ? Ces questions, au cœur du paradoxe humain entre nature et culture, sont abordées dans plusieurs ouvrages littéraires et films, où elles vont de l’interrogation philosophique au dilemme cornélien.
Dans Children of Men, avant la grande fuite, on est invité de manière furtive à passer une soirée avec un Ministre qui vit isolé, entouré d’œuvres d’art grandiloquentes et d’une poignée de serviteurs. La Vénus de Milo a été acheminée à grand mal et, après ses bras, a perdu un bout de jambe. Guernica trône dans une salle à manger immense. La Pieta, quelques Velasquez, deux Goya. Personne ne semble les regarder. Sauf lui. Quand son visiteur s’étonne : « Dans cent ans il n’y aura plus une seule personne pour voir ça… Qu’est-ce qui te fait continuer ? », il répond : « Tu sais quoi ? Je n’y pense tout simplement pas ». Il le fait. Parce qu’il peut le faire. Et en acquiert une forme de dignité. Le personnage n’a pourtant rien de sympathique, mais cette forme de recueil systématique, de sauvetage sans justification, éveille comme un écho de ces actes gratuits qui ne demandent rien en retour, et n’espère aucune victoire future. Qui demandent simplement à être accomplis.
Naturellement, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Mais d’autres récits témoignent d’une combativité de l’âme propre à triompher du désespoir. Dans La Peste Écarlate, nouvelle post-apocalyptique de Jack London, un vieillard conte à ses petits-enfants le monde d’avant. C’est un ancien universitaire et la langue qu’il utilise, ses mots précis et savants, peinent à retenir l’attention des jeunes sauvageons que sont devenus les enfants, cruels, frustes et ignorants. Pourtant il leur parle, sans travestir sa langue. Sans omettre d’éléments. Sa dignité du présent réside dans le fait de perpétuer un certain engagement dans le verbe, l’exigence du terme juste. Comment parler de virus et de microbes, de la peste qui a dévasté le monde, à des enfants qui n’ont jamais vu un microscope ? Comment désigner des choses qu’on ne voit pas, si ce n’est à l’aide d’un langage précis, qu’il faut perpétuer et enseigner ? Le vieil homme a donc recueilli des livres, soigneusement entreposés à l’abri et accompagnés d’un alphabet, dans l’espoir que la civilisation humaine reprenne son ascension vers le savoir et que l’un d’entre eux, un jour, retrouve la curiosité d’apprendre, le goût des mots et de la transmission par l‘écriture. Une Pierre de Rosette dans le crépuscule de notre ère, avec l’impression féroce d’être le dernier Homme de son espèce sur Terre.
Face à l’apocalypse climatique, renoncer aux livres peut devenir une question de vie ou de mort. Dans Le Jour d’Après, des habitants se réfugient dans une bibliothèque gigantesque, la New York Public Library. Les températures glaciales qui s’abattent sur la ville font rapidement du feu une condition de survie. La notion de foyer prend tout son sens ici. Or dans ce foyer-refuge, les étagères sont remplies de papiers imprimés qui, après quelques hésitations, finissent par changer de fonction : l’impératif de survie prend le pas sur la soif de culture. Le récit devient combustible ; l’œuvre de l‘esprit, source de chaleur pour le corps.
Cet incendie littéraire fait inévitablement penser aux autodafés, à la différence notable que leur motif n’est pas lié à des conditions matérielles d’existence, mais purement idéologique. L’autodafé de livres et de manuscrits est une vieille tradition : du premier empereur de Chine 3e siècle avant J.-C. brûlant les écrits confucéens, au premier roi catholique d’Espagne au 6e siècle, jusqu’aux nazis et au franquisme. Plus récemment, à la fin des années 90 les talibans détruisirent 55.000 livres rares de la plus vieille fondation afghane ; en 2015 l’État Islamique brûla 2.000 livres à Mossoul. L’éradication systématique des écrits contraires à une nouvelle foi qui veut s’imposer en faisant table rase du passé, qu’elle soit religieuse ou politique, est une des caractéristiques communes des régimes totalitaires. Elle a pour seul mérite de reconnaître la puissance des idées et des mots qui leur servent de messagers.
C’est bien de ces autodafés à velléité dogmatique, dont il est question dans Fahrenheit 451. Le titre de ce roman d’anticipation de Ray Bradbury, adapté au cinéma par François Truffaut en 1966, désigne la température à laquelle le papier s’enflamme ; elle équivaut dans notre système à 232,8 °C. Dans cette société dystopique, le savoir est devenu une menace, les livres sont interdits. Le métier du personnage principal, Montag, consiste à repérer les ouvrages imprimés et à les détruire par le feu. Les pompiers de l’après sont désormais pyromanes. Dans cette société sans écrits, la résistance s’incarne dans des « hommes-livres » qui déambulent en forêt en récitant, inlassablement : leur acte d’insoumission consiste à apprendre par cœur ces livres pour les sauver de l’oubli. Le Prince de Machiavel, Orgueil et Préjugés de Jane Austen (partagé entre deux jumeaux : Orgueil, et Préjugés), La République de Platon, et – en clin d’oeil – Chroniques martiennes de Ray Bradbury, tous ces ouvrages n’existent désormais plus que par la mémoire de leurs incarnations. Peut-être est-ce également un moyen pour leurs porteurs d’échapper à la détresse, repliés dans leurs mondes de mots et de récits. Comme le personnage du Joueur d’échecs de Stefan Zweig s’entraînant mentalement dans sa geôle, d’autres prisonniers, déportés, torturés ont témoigné n’avoir survécu sans sombrer dans la folie à des conditions de détention particulièrement dures qu’en se remémorant des poèmes et récits. La résistance se vit, s’écrit, parfois elle se récite aussi.
En Norvège une ancienne mine désaffectée abrite une bibliothèque de fin du monde depuis le Printemps dernier : une gigantesque salle sécurisée, cachée sous une montagne de l’île du Spitzberg, à 1.000 km du pôle Nord. Au même endroit repose la Réserve mondiale de semences du Svalbard, 541 millions de graines de plus de 843.000 espèces différentes. Deux arches de Noé destinées à préserver nourritures du corps et de l’esprit, las elles-mêmes déjà menacées par le réchauffement climatique qui fait fondre le permafrost et s’insinue sous forme d’humidité dans les caves à -18°C.
Children of Men (Les fils de l’homme) de Alfonso Cuarón, 2006
The Scarlet Plague (La Peste Écarlate) de Jack London, 1912
The Day After Tomorrow (Le Jour d’Après) de Roland Emmerich, 2004
Fahrenheit 451, Ray Bradbury (1953) adapté au cinéma par François Truffaut, 1966